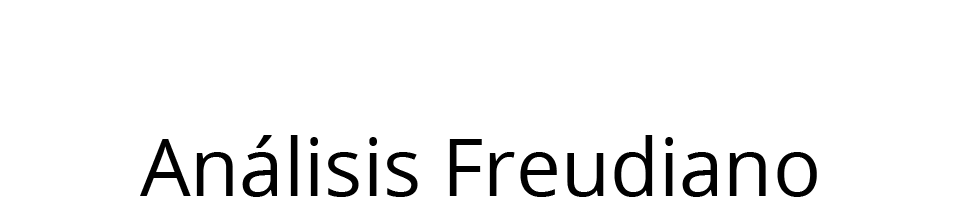Avatars du nom propre- Chantal Hagué
Avatar vient du sanscrit Avatara : il désigne, dans la religion hindouiste, chacune des incarnations du dieu Vishnou. Au figuré, il signifie métamorphose, transformation d’un objet ou d’un individu qui en a déjà subi plusieurs, mais il peut aussi prendre le sens de mésaventure et, dans le domaine informatique, le sens de l’apparence que prend une personne dans un univers graphique virtuel, quelquefois en 3D, comme dans le film Avatar de James Cameron qui fait actuellement le tour du monde.
Je trouve qu’il convient particulièrement bien à mon propos sur les différentes facettes que peuvent constituer les changements du nom propre, à travers les mésaventures qu’il peut subir, et ses liens avec le Nom-du-père et la fonction paternelle.
Si le nom propre représente une des voies d’accès possible au Nom-du-Père, les deux étant dans un rapport direct, je me suis demandé en effet quel impact pouvait avoir sur le Nom-du-Père un changement du nom, ou sa transformation, et quelle pouvait en être la part cachée d’un dénigrement du père propice à mettre à mal cette métaphore du Nom-du-Père, si utile à la construction d’un sujet.
Autre point d’interrogation : comme l’autorise maintenant en France une loi récemment promulguée, une mère peut choisir de donner à son enfant son nom au lieu de celui de son père, usage en place depuis des générations. (…) Quels peuvent être les effets de ce changement dans les règles d’attribution du nom propre ? Comment tel enfant élevé dans une famille monoparentale, et qui de surcroît porte le nom de sa mère, va-t-il pouvoir échapper à ce dénigrement du père réduit au géniteur, donc au dénigrement de sa fonction, sinon à sa forclusion ?
Nous connaissons l’importance qu’a dans toute analyse le nom propre. Nous devons toujours y prêter attention dans la mesure où le nom propre touche au plus intime du sujet.
Un nom propre, c’est ce que l’on reçoit à la naissance avec son corps sexué et ce qui reste, après la mort, quand le corps disparaît, inscrit sur une tombe ou dans un registre de l’état civil. On le reçoit sans le choisir.
Dans son séminaire sur l’Identification, Lacan précise que la spécificité du nom propre tient non pas tant à son absence de sens, ainsi que l’entend Russell, ou à sa seule caractérisation sonore, ainsi que le prétend Gardiner, mais à l’enracinement du sujet dans le champ du langage, dans le champ de l’Autre. Il parle d’un rapport de l’émission nommante avec quelque chose qui, dans sa nature radicale, est de l’ordre de la marque, du trait, de la lettre (dimension du réel). Preuve en est que le nom propre se transfère d’une langue à l’autre, mais ne peut se traduire. En revanche, c’est grâce à lui que l’on peut déchiffrer une langue inconnue : il faut seulement attendre d’avoir une inscription bilingue, et ensuite on cherche un nom propre parce que c’est à peu près le même dans les deux langues. C’est à partir des noms de Ptolémée et de Cléopâtre que Champollion a pu ainsi déchiffrer la pierre de Rosette.
On peut dire ainsi que le nom propre est plus lié qu’un autre à la structure du langage et plus particulièrement au trait qui fait unicité du sujet, c’est en cela qu’il identifie l’enracinement du sujet (à reformuler ici ?).
Le nom propre a donc son importance dans chaque analyse puisque ses lettres peuvent se retrouver dans les formations de l’inconscient du sujet, aussi bien ses rêves, ses lapsus que ses symptômes. La clinique de Freud nous en offre plusieurs exemples, à commencer par l’analyse de l’oubli du nom Signorelli dans laquelle Lacan y lit comment ces trois lettres ” S. I. G ” sont issues du nom propre de Sigmund Freud.
En 1961, lorsque Lacan commente le nouvel épisode de la phobie du petit Hans où ses angoisses se cristallisent non plus sur les chevaux, mais sur la grande girafe et la petite girafe chiffonnée, connaissait-il le patronyme de Hans ? A ce moment-là, en tout cas, il n’en parle pas. C’est seulement, 15 ans plus tard, au moment de la publication des « Minutes de la société psychanalytique de Vienne », dans sa version française, que l’on découvrit le nom du père de Hans : Max Graff (Graff / Girafe). Dans ce fantasme aux deux girafes, Hans, à sa manière, a inscrit quelque chose de sa rivalité en utilisant les lettres de son nom.
Cela vient étayer, en tout cas, la thèse de Lacan sur la fonction de la phobie en tant qu’elle introduit un ressort signifiant-clef qui permet au sujet de préserver un minimum d’ancrage pour ne pas se sentir complètement à la dérive du caprice maternel. Ce signifiant-clef, dans l’après-coup, c’est le nom du père puisque Hans, pour fabriquer son rêve et y inscrire quelque chose de son désir, a utilisé son nom. C’est là que s’articule la dimension symbolique.
Chez Lacan, la première apparition du Nom-du-Père, soit le père comme fonction symbolique, date de 1951. Il s’agit alors de l’écrire au singulier. Le Nom-du-Père est un refus fait à l’enfant de jouir de sa mère, et un refus à la mère de jouir de l’enfant. C’est un signifiant qui représente tout ce qui touche à la loi, au langage, au nom. Tout ce qui touche à la différence des sexes. Bref, tout ce qui fait différence et qui permet à l’enfant, de se sortir de la relation duelle avec la mère. Le père est cette incarnation du signifiant, du fait même qu’il nomme l’enfant de son nom. Ainsi, il intervient auprès de celui-ci en tant que privateur de la mère. Le Nom désigne donc cette partie que l’enfant n’a pas, qui est orientée vers un autre, qui est nommable par le désir de la mère : le Nom-du-Père.
Cette triangulation entre la mère, l’enfant et le phallus, que le père réel personnifiera ou non, sera vécue par l’enfant comme « être ou ne pas être le phallus », d’où la fonction structurante du père en tant qu’il nomme l’interdiction œdipienne. Cette métaphore paternelle est donc une opération de castration. Là où défaille le père réel, il est fait appel au père symbolique dont la fonction est de garantir la castration. Le père n’est donc pas seulement un géniteur, mais une fonction qui dépend de la manière dont un sujet assume le signifiant dans le champ du langage.
Si le nom propre a cette fonction de suture, et cela pas au même endroit selon qu’il s’agit de névrose, de perversion ou de psychose, quels sont les effets sur le sujet quand il y a changement du nom ou transformation ?
De nombreux exemples se rencontrent dans notre clinique quotidienne.
Dans les cures d’adultes qui ont été des enfants adoptés, se pose à un moment ou un autre la question de leur nom d’origine. Combien sont ceux qui ne le connaissent pas et qui se retrouvent devant un trou initial ? Pour ceux qui le connaissent, se pose alors la question de la façon dont ils l’ont appris.
Ces questions sont abordées dans les cas d’adoption mais pas seulement, elles concernent tout changement de nom lié à l’histoire particulière d’un sujet.
Comme, par exemple, tel patient qui découvre pendant sa cure que son nom propre est un nom d’origine juive qui a été francisé par son père après la guerre. Une transformation du nom, mise en place par le père pour des raisons de survie certes ou pour une intégration plus facile, mais cachée aux enfants, n’est pas sans effet sur le sujet du fait de l’opération d’effacement qu’elle comporte.
Je pense à une autre patiente qui n’a pas été adoptée, mais abandonnée à la naissance puis reprise par sa mère et ensuite reconnue par son père, et tout cela dans ses six premiers mois. Sa mère, issue d’une famille marquée par de nombreux abus sexuels, subit à son tour un viol. Quand quelques semaines après, elle découvre qu’elle est enceinte, c’est le drame. Comment savoir qui est le père ? la question s’est d’abord posée au niveau de qui était le géniteur. Son fiancé a vou
lu qu’elle avorte, elle a refusé, mais sur l’insistance du fiancé, elle a abandonné l’enfant qui, recueillie dans un centre de l’Assistance Publique a reçu un premier nom qui d’ailleurs était un prénom. Trois mois après, la mère est allée la chercher pour la reconnaître. Cette patiente a reçu un deuxième nom, celui de la mère. Puis, comme le fiancé n’en voulait toujours pas, elle l’a donnée en garde à sa propre mère, le temps pour cet homme d’accepter l’enfant dont somme toute il pouvait être le géniteur. Ce qui se produisit. Il a même choisi la période de Noël, en tant que date symbolique, pour accepter de la reconnaître. Son livret portait les traces de ces aléas du désir de ses parents : sur les deux lignes au-dessus du nom de son père, il y avait deux noms rayés.
Quand elle a eu 13 ans, un jour, son père lui a appris la vérité. Peu de temps après, elle prenait sa première cuite et était hospitalisée pour coma éthylique, le premier d’une longue série. Son analyse a mis à jour, entre autres, le fait que ce symptôme était pour elle une façon de s’absenter en tant que sujet, et que cette disparition était liée aux ratures inscrites sur son livret de famille, au niveau des différents noms attribués pendant ses six premiers mois, comme autant de traces d’un parcours particulièrement chaotique.
Au lieu de reconnaître en retour ce père qui en quelque sorte l’avait adoptée, lui refusant au contraire cette fonction du Nom-du-Père, elle lui reprochait violemment d’avoir forcé sa mère à l’abandonner. Ainsi cela permettait à cette patiente de mettre ce père réel dans le lot des hommes violeurs. Les hommes étaient méprisables et elle, elle était homosexuelle.
À propos d’une mère qui se demandait si elle devait changer le nom de son premier enfant qu’elle avait eu avec un homme qui s’était éclipsé, pour lui donner le nom du père de ses autres enfants, mettant ainsi en quelque sorte ce premier enfant sur le même pied que les autres, Françoise Dolto répondait : « Un enfant qui a porté un nom doit le garder toute sa vie, à moins que ce nom n’ait changé quand il était tout petit, avant qu’il ne parle… Changer le nom d’un enfant à 10 ans est l’équivalent pour l’inconscient d’une fracture de la colonne vertébrale. »
Dans son article « Changer de nom: manquer à perdre » paru dans le n°7 de Clinique Lacanienne, Jean-Pierre Lebrun trouve cet avis exagéré et trop surmoïque. Il y relance cependant la question fondamentale concernant le poids que peut représenter pour le sujet un changement du nom. « C’est qu’à changer de nom, dit-il, ce qui peut être induit, c’est le risque de manquer l’opération de la perte. ». Le nom propre est ce qui, augurant de la potentialité d’un sujet à se soutenir de sa seule énonciation, désigne à minima cette opération nécessaire à ce qu’un sujet puisse se dire et pas seulement être dit. Il en est la cicatrice. Il est la cicatrice de l’humanisation du sujet. Cicatrice qui, à l’instar de l’ombilic, est la marque d’une coupure, de la coupure signifiante Le nom propre est le nom même de l’innommable perte.
Au nom de la liberté individuelle et avec la multiplication des offres alléchantes que nous propose la science, l’une des caractéristiques de l’époque contemporaine, en Occident surtout mais aussi dans certains pays émergents, est l’importance accordée au choix : choix du mode de procréation, choix d’un nouveau visage par le moyen de la chirurgie esthétique, choix d’un autre sexe pour les transsexuels etc. Les règles d’attribution du nom de famille subissent aussi les aléas de cette tendance : en France, depuis le 1er janvier 2005, la loi autorise les parents à donner à leurs enfants, soit le nom du père soit celui de la mère, soit leurs deux noms accolés dans un ordre choisi par eux. Que penser de cette loi sociale qui met dans une équivalence faussement symétrique, matronyme et patronyme ?
Il me semble évident que cette fonction du Nom-du-Père fonctionnera pour le sujet de façon différente, selon que son nom de famille sera ou non le nom de son père.? Qu’en est-il pour le sujet quand l’enfant porte non pas le nom du père mais celui de la mère? Comment la métaphore paternelle sera-t-elle soutenue par la mère dans le cas où celle-ci préférera donner à son enfant son nom à elle plutôt que celui du père ? Porter le nom de son père n’a jamais été une garantie de bonne santé psychique, mais n’y a-t-il pas dans cette loi le risque d’accentuer une dérive aux effets imprévisibles non sans contrecoup pour le sujet ? Dans le fait que la loi encourage ce qui abolit la structuration subjective, n’y a-t-il pas là un risque de désintégration de la métaphore paternelle que ce soit pour une fille comme pour un garçon ?
Ces mutations contemporaines de la promotion de la jouissance, sous forme d’impératif et sans temporisation du dispositif narcissique ( ?), affectent aujourd’hui les conditions de l’identité subjective, désormais sous le primat, non plus du Phallus , de l’interdit et de la castration, mais des lois du marché dérégulé et de l’échange.
Il est à craindre que les effets nocifs de cette loi ne se retrouvent à la génération suivante. D’après cette loi, les enfants à leur tour pourront choisir pour leur enfant le nom du père ou celui de leur mère. Quand c’est le nom de la mère qu’ils choisiront en fonction de la pente oedipienne, au prix de quels symptômes ces enfants auront-ils à assumer la culpabilité de ce nom du père rayé ?
Certaines personnes ont changé leur nom parce qu’il leur paraissait ridicule. Cela aussi la loi le permet. Ce qui est posé là, c’est la question du nom propre lié à un signifié trop prégnant qui met l’imaginaire au premier plan, et risque d’écraser le signifiant du Nom-du-Père en tant que fonction. Quand le signifié se met sur le devant de la scène, cela induit un risque pour le signifiant de Nom-du-Père, celui de ne plus pouvoir être opérant.
Un patient m’explique que son fils de 13 ans lui a parlé de son intention de changer dès qu’il le pourrait son nom si ridicule, soumis aux plaisanteries de ses camarades. A cela, il lui a répondu aussitôt que oui, il était d’accord. Lui-même ayant subi cette situation de moqueries comme sa mère dés qu’elle s’est mariée et qu’elle a porté le nom de son père, il avait donné son nom au garçon, mais à ses deux filles il avait donné le nom de leur mère. L’aînée des filles a présenté dès l’école primaire un symptôme de débilité dont elle a pu sortir grâce à un travail psychanalytique, et la deuxième commençait, au moment de cette séquence clinique, à présenter le même symptôme que sa sœur. Je lui ai fait remarquer que changer son nom n’allait pas de soi, que l’on n’abandonnait pas le nom de son père comme ça. Cette remarque a touché chez lui un point délicat puisque la séance suivante, il annonçait qu’il pensait arrêter là les séances. Heureusement la cure a pu continuer.
Qu’en est-il pour ce père, de son rapport au Nom-du-Père et à la ternarité que cette fonction représente ? N’est-ce pas en fonction de son propre rapport à la métaphore paternelle qu’il pourra ou non transmettre à son fils quelque chose de cette ternarité ?
Plus tard dans sa théorisation, Lacan donnera au Nom-du-Père un ancrage encore plus important dans le registre de la nomination. Le Nom-du-Père devient à la fois le nom donné au Père, (celui reconnu par la mère et qui occupe sa place dans la métaphore paternelle), le nom par lequel le père peut se désigner (le Père qui répond à la question de son nom), et le nom donné par le Père. C’est donc non plus seulement le nom donné au père, mais le nom donné par le Père. Ce renversement de sens est supporté par le trou du noeud borroméen, « un trou « inimaginable », comme le qualifie Lacan qui poursuit : « La nomination c’est
la seule chose dont nous soyons sûrs que ça fait trou. »
Je vous propose une dernière vignette clinique qui illustre, me semble-t-il, ce propos. Un patient raconte un rêve : « J’allais voir quelqu’un, c’était plutôt un jeune, qui était enfermé dans un endroit, quelque chose entre un hôpital et une prison. Il était seul dans l’obscurité la plus totale. Je lui parlais et au moment de partir, comme en somme j’allais l’abandonner, je lui laissais mon nom. » (c’est-à-dire son patronyme).
Je ne rentrerai pas dans les détails mais ce rêve a été un tournant dans la cure. Depuis, il a parlé de sa douleur d’enfant qui avait été comme une « agonie » par rapport à l’effacement de son père, « disparu avant d’être advenu », comme il disait lui-même. Il a mis sur le compte de la vénération que le père portait à sa propre mère disparue très tôt, le fait que ce père l’ait « abandonné » tout au long de son enfance à une mère mélancolique. Son père lui répétait : « Ta mère est très fatiguée, sois très sage avec elle », avant de partir pour de longs voyages.
Il me semble que dans ce rêve, par l’appel de son nom propre, ce n’est même pas le Père imaginaire qui est convoqué pour tenter de suppléer les insuffisances du père réel. C’est le Père symbolique en tant que dernière instance qui est appelé à la rescousse dans cet état de détresse et de désastre narcissique.