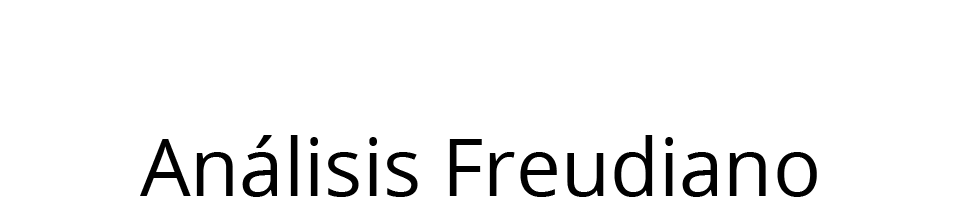LYON François Christophe "Les robinsons de notre modernité : les phobiques scolaires."
Journée AF de Lyon 14.09.2013
Introduction : Sur son ile, Robinson, le héros du roman de Michel Tournier décide pour « s’arracher à l’abîmede bestialité où il avait sombré », de rédiger un « log-book », où il consignera « ses méditations, l’évolution de sa vie intérieure, ou encore les souvenirs qui lui revenaient de son passé et les réflexions qu’ils lui inspiraient. »
Dès le début de cette entreprise qu’il qualifie « d’entrée dans le monde des esprits » il écrit : « Désormais, que je veille ou que je dorme, que j’écrive ou que je fasse la cuisine, mon temps est sous- tendu par un tic tac machinal, objectif, irréfutable, exact, contrôlable…je veux, j’exige que tout, autour de moi soit dorénavant mesuré, prouvé, certifié, mathématique, rationnel.
Cette dose massive de rationalité que je veux administrer à Spéranza (nom de l’ile donnée par Robinson) en trouverais-je la ressource en moi-même ?….
Il est inutile de se le dissimuler : tout mon édifice cérébral chancelle.
Et le délabrement du langage est l’effet le plus évident de cette érosion. »
C’est une même dose de rationalité excessive que l’on retrouve dans la classification statistique internationale des maladies et des problèmes de santé connexe, 10e révision, plus connue sous l’appellation CIM 10, où l’on peut répertorier plus de 16000 codes différents permettant de faire autant de diagnostics !
A ce jour, la phobie dite scolaire n’est pas répertoriée, du moins pas encore…
Ce nouveau symptôme de notre post- modernité échappe encore au classement.
On peut toujours essayer de lui trouver une place au chapitre 5 des « troubles mentaux », section F93 intitulée « Troubles émotionnels apparaissant spécifiquement dans l’enfance » dans un de ses 3 sous chapitres :
• F930 : « Angoisse de séparation de l’enfance. »
• F931 : « troubles anxieux phobiques de l’enfance. »
• F932 : « anxiété sociale de l’enfance. »
Soutenir l’actualité de l’inconscient, ne pas céder sur son inactualité, c’est, à mon sens, poser encore et toujours cette question :
Qu’est ce que le sujet nous dit avec son symptôme ?
De quoi ça parle ?
Ainsi,( qu’est ce= à enlever) que nous disent les phobiques scolaires?
Qui sont ces naufragés de la scolarité? Ces naufragés d’un système où chaque question a sa réponse et réciproquement.
De quel savoir sont-ils les porte-paroles ?
En quoi l’enfant phobique de sa scolarité ressemble-t-il à Robinson, le héros du roman de M. Tournier?
En quoi l’enfant phobique est-il un Robinson de la post- modernité?
En attendant qu’une 11e révision de la CIM s’en saisisse, et que le dire des sujets phobiques de la scolarité disparaisse avec, (et se re-déploie dans d’autres symptômes ?) je souhaiterais partager avec vous quelques pistes de réflexion.
J’organiserai mon exposé en 3 parties :
1) quelques précisions sur la phobie scolaire en question.
2) » le piège à singe » ou quand le sujet s’empare de l’objet, de « l’hors-dit ».
3) illustration clinique : Robinson, l’enfant des limbes ou la présence d’Autrui comme condition de la possibilité de se séparer de l’objet et vivre sa solitude.
1) Il n’y a pas plus de 10ans que la phobie scolaire est apparue dans les nouvelles demandes qui affluent dans les CMP et je dois dire avec quelques autres que je la rencontre de plus en plus souvent.
Qu’,-ceà dire alors de ce symptôme ?
S’agit-il là d’un « néo- symptôme » qui consacrerait les « néo- sujets » de notre époque, ou s’agit-il d’une nouvelle forme d’expression de la phobie, autrement dit d’un nouveau symptôme produit par les sujets de notre post- modernité ?
(Mais=inutile) Pour pouvoir répondre à cette interrogation, il nous faut d’abord essayer de cerner de plus près ce qu’est la phobie dite « scolaire ».
Ce symptôme concerne le plus souvent des jeunes pré- adolescents aux alentours de l’entrée au collège (entre 9 et 12 ans).
Si le terme de phobie scolaire désigne assez clairement l’impossibilité pour ces jeunes de se rendre au collège pour suivre leur scolarité, il reste très discutable d’un point de vue clinique, car dans les dires des jeunes patients que je rencontre, la scolarité est dans l’ensemble normalement appréciée.
(Comme= à enlever)Pour pas mal d’élèves, il y a des matières (qu’ils apprécient,= à enlever)appréciées, d’autres moins bien…
Des « profs » qui ont leurs qualités et leurs défauts…
Des ami(e)s avec (qui= à enlever)lesquels(lles) ils s’entendent plus ou moins, c’est selon …
Bref, ces jeunes n’ont pas une aversion marquée pour leur scolarité.
Mieux encore,ils n’en ont pas peur, si l’on reprend ici l’étymologie de phobie qui vient du grec « phobos » = la peur.
Mais de quoi ont-ils peur ?
Quand la phobie est déclarée, l’angoisse se manifeste au moment de sortir de la maison, les maux de ventre sont de plus en plus douloureux et c’est le vertige qui saisit ces jeunes en dehors de chez eux.
Le seul recours possible est alors de se replier chez soi, le plus souvent dans sa chambre et pour certains dans leur lit.
On peut repérer dans l’anamnèse des signes précurseurs comme des absences répétées ou des manifestations anxieuses, notamment le dimanche soir, au moment du coucher.
La qualité du sommeil est altérée et la fatigue est de plus en plus présente le matin…
Bref, le jeune traîne des pieds pour se lever jusqu’au jour où il n’y arrive plus, c’est plus fort que lui, l’angoisse le cloue à domicile.
C’est donc la peur de quitter la maison qui opère ici.
L’angoisse, qui est au premier plan dans les manifestations cliniques est une porte d’entrée intéressante pour préciser cette peur.
Je reprendrai ici rapidement, ce qui est écrit à sonsujet dans le dictionnaire de la psychanalyse de Roland Chemama : (concernant l’angoisse=inutile) » Freud la repère tout d’abord en 1894 comme la cause des troubles névrotiques qu’il lie à la sexualité. Pour lui, « l’angoisse découle d’une transformation de tension (physique ou psychique) accumulée. »
En 1926, dans « Inhibition, symptôme et angoisse » (Freud=inutile) il revient sur sa position concernant le lien entre l’angoisse et la libido sexuelle d’une part, et le lien entre le Moi et l’angoisse (le Moi étant considéré alors comme le siège unique de l’angoisse) d’autre part.
Il (re)considère l’angoisse soit comme une réaction inconsciente, involontaire et automatique face à un danger, soit comme volontaire, consciente produite par le Moi quand une situation de danger réel le menace.
Freud distingue enfin 2 niveaux d’angoisse :
• une angoisse originaire produite par l’état de
détresse psychique du nourrisson séparé de sa mère ;
• une angoisse comme signal en réaction au danger de la castration au moment de la phase phallique.
Pour Lacan, qui y consacrera un séminaire, (1962/63) « l’angoisse est un signal, non pas d’un danger interne ou externe, mais de la confrontation au désir de l’Autre. »
Si pour Freud, l’angoisse est causée par le manque d’objet, chez Lacan, l’angoisse est la seule traduction subjective de ce qu’est la quête de l’objet perdu, de l’objet support et cause du désir, qu’il nommera objet a.
Pour qu’un sujet puisse être désirant, il faut que cet objet a, cause de son désir, puisse manquer au sujet.
Lacan dira que l’objet a, c’est l’objet sans lequel il n’est pas d’angoisse.
L’angoisse n’est pas le signal d’un manque mais la manifestation pour un sujet d’un défaut de cet appui indispensable qu’est pour lui le manque. »
L’angoisse, « c’est la tentation non pas de la perte d’objet, mais la présence de ceci que les objets, ça ne manque pas. »(5/12/1962)
On peut dire que l’angoisse est un signal de manque de possibilité de manque.
Est-il possible d’avancerque ces jeunes ont une peur irraisonnée de manquer au moment de quitter le domicile ?
2) Quand je demande à ces pré-adolescents comment ils occupent leur journée sans aller au collège, et pour certains pendant plusieurs mois, je tombe régulièrement sur cet écueil :
« Je joue. »
Et à quoi ?
« Ben aux jeux, sur ma PS ou mon ordi. »
Et le temps passe comment ?
« Ben je m’en rends pas compte. »
Ainsi, ces jeunes n’ont pas le temps de s’ennuyer à la maison, car le temps ne compte plus.
Ils s’engagent au fil des jours dans une forme d’a-temporalité où les journées se suivent et se ressemblent et sont marquées du sceau d’une répétition mortifère.
Les objets, « ça ne manque pas » et ils peuvent tout aussi bien passer de la PS à la DS (!), de la DS à l’ordi, de l’ordi au portable, du portable à la télé, etc.
Dans un article paru dans la revue « Che vuoi » en 01/2008, intitulé « Une économie de l’arrière-pays », Jean-Pierre Lebrun emprunte à un politologue, Benjamin Barber (« Comment le capitalisme nous infantilise », Paris Fayard 2007) ex- conseiller de Bill Clinton l’analyse suivante :
« Nous sommes passés d’un capitalisme productiviste à un capitalisme consumériste, et la cage d’acier de la modernité décrite par le sociologue Max Weber est remplacée de nos jours par la cage du « piège à singes ».
En Birmanie, pour attraper les singes, les autochtones ont mis au point un piège très simple. C’est un bocal transparent lié par une chaîne à un tronc d’arbre. Dans le bocal ils placent une friandise ayant la taille d’une orange et une consistance dure. Le singe voyant la friandise met la main dans le bocal pour l’attraper, mais une main entourant la friandise ne passe plus par l’ouverture du bocal. Donc le singe ne peut retirer la main du bocal qu’en lâchant la friandise. Comme il ne veut pas renoncer à ce qu’il considère comme à lui, il se fait prendre et tuer.
On dit que certains d’entre eux préfèrent mourir plutôt que de lâcher leur proie.
Peut-on affirmer que ces jeunes pré- ados sont enfermés chez eux comme dans la cage du « piège à singe » ?
Par défaut de pouvoir lâcher l’objet, de pouvoir y renoncer, ils restent englués dans leur jouissance en se cramponnant à l’ « Hors dit », en restant dans un entre-deux, pas tout à fait « hors » ni tout à fait « dans » le dire.
Ils sont comme en retrait du symbolique, comme s’ils avaient fait un pas de côté dans un lieu qu’il convient alors de préciser.
Lebrun appelle ce lieu de repli, l’arrière-pays de l’économie œdipienne, un lieu où le désir n’est pas encore advenu, car il n’y a pas la possibilité du manque.
Quitter ce lieu, autrement dit, quitter le domicile pour se rendre au collège, c’est réactiver l’angoisse qui vient signaler un défaut d’appui sur la possibilité de manquer.
La seule manière de suppléer à leur difficulté c’est de rester à la maison, le plus souvent dans leur chambre, qui devient au fil des jours non pas un îlot de solitude mais Spéranza, l’ile de Robinson, le lieu de l’isolement, autrement appelée « Les limbes du Pacifique ».
L’historien Jacques le Goff dans son livre « Un autre Moyen Age » évoque les limbes à travers l’histoire du christianisme.
Le mot limbe vient du latin limbus qui signifie bordure.
Les limbes désignent deux bordures de l’enfer.
On distingue deux limbes :
• celui des patriarches prophètes de la Bible, qui avaient annoncé la naissance de Jésus, et les âmes des justes morts avant la résurrection de Jésus-Christ. (Ces âmes, qui ne pouvaient entrer au paradis scellé depuis la faute d’Adam, sont libérées par Jésus lors de sa descente aux enfers.)
• celui des enfants, qui sont morts avant d’avoir pu être baptisés.
Les limbes ne sont ni le paradis (lieu de la vie éternelle), ni l’enfer (lieu destiné aux supplices des damnés), ni le purgatoire (lieu d’attente et d’espoir d’être admis au royaume des cieux).
Dans la topologie chrétienne, les limbes désignent un 4e espace, un lieu d’attente éternelle, selon l’expression de Le Goff, autrement dit, un lieu d’attente sans espoir.
C’est le lieu de l’Impossible car quel être humain peut attendre sans espoir, le mélancolique peut- être ?
Pour Robinson, Les Limbes du Pacifique sont le lieu de l’alternance, entre espoir et désespoir :
• espoir qu’un autre homme, un homme nouveau naisse en lui de ce naufrage ;
• désespoir qui le gagne (…) chaque fois qu’il arrive au bout d’un projet qui l’a occupé de longs mois.
Chaquefois, il finit « vidé, épuisé » et devient alors « une proie facile pour le doute ».
Il se met à douter du bien-fondé de son entreprise, qui parfois lui parait vaine et folle à savoir :
Pouvoir vivre sans autrui.
La question que pose Robinson est celle-ci: est-il possible pour un être humain de pouvoir vivre dans les limbes … et plus précisément, avant tout de pouvoir y rentrer ?
Est-il possible de rentrer vivant dans ce lieu des enfants morts avant le baptême, autrement dit dans ce lieu de l’enfance préservée encore du baptême du symbolique?
Est-il possible de se « débaptiser » du symbolique? Pour un chrétien, la « débaptisation » consiste à demander la suppression de son nom sur les registres paroissiaux afin de ne plus être compté comme membre de l’église.
Pour un parlêtre, à qui s’adresser pour
se débaptiser de l’Autre ?
Que se passe t-il donc pour ces jeunes pré- ados pris au piège de l’objet de leur jouissance ?
L’angoisse qui les saisit au moment de se séparer de l’objet révèle ce défaut de pouvoir prendre appui sur le manque.
Sont-ils dès lors condamnés à entrer dans les limbes ?
C’est à l’aide d’une illustration clinique que nous allons maintenant poursuivre.
3) Robinson, l’enfant des limbes :
Robinson a 11 ans quand le professeur principal du collège alerte ses parents sur les difficultés de leur fils et leur demande de prendre rendez-vousauprès d’un « psy ».
En effet, tous les matins, Robinson se rend à l’infirmerie en disant « qu’il n’est pas bien ». Puis« les choses s’améliorent en cours de journée » jusqu’au lendemain.
Robinson est l’enfant unique d’un couple marié et recomposé du côté paternel.
Cela fait déjà quelquetemps que sa mère pensait consulter car, deuxans auparavant, à l’occasion d’une classe verte, une « première séparation » (dixit la maman) avait été une véritable « catastrophe » selon ses termes.
Au 1er entretien, Robinson dira « faire des crises d’angoisse » qui lui font mal au ventre et le font pleurer.
Les maux de ventre, ilconnaît, il en avait quand il était nourrisson.
Il avait, dira sa mère des coliques, « et il se calmait que sur moi ».
Il avait également des « problèmes de constipation » qui s’estompaient grâce aux massages ventraux, faitspar sa mère.
Sa mère dira être « très fusionnelle » avec Robinson, à tel point qu’elle dort encore avec lui.
Son père me parlera davantage de ses difficultés de couple et de la folie « privée » de sa femme avec leur fils.
Il me confiera que lorsqu’il est trop énervé, il va au fond du jardin fumer une cigarette en compagnie de ses poules qui, elles au moins, « ne lui prennent pas la tête ».
Il me dira également « avoir grandi dans les jupes de sa mère ».
« On habite dans une impasse », conclura la mère, à la fin de notre 1er rendez-vous, et je trouvais alors que cette expression convenait parfaitement à la situation.
Comment Robinson allait-il pouvoir sortir de cette impasse préœdipienne?
Il trouvera sa solution, celle qui lui fera renoncer à son symptôme phobique qui s’installait de jour en jour.
Je vous restitue le dénouement=inutile, à enlever
Alors que je demandais à Robinson de ne plus dormir avec sa mère, il me répliquait, à ma grande surprise, « qu’il le ferait bien volontiers mais que c’est elle qui le rejoint chaque nuit dans son lit et qu’il ne sait pas comment faire. »
Je lui suggère d’être plutôt ferme avec elle et de lui signifier que ce n’est pas sa place, que sa place est auprès de son père, son mari donc, et que si cela ne lui convient pas, que ce n’est pas l’affaire de Robinson, elle peut aussi dormir sur le canapé…
Peu de temps après, il me dira avoir essayé mais en vain, car sa mère ne tiendra pas compte de sa requête.
Je commençais à envisager de recevoir sa mère seule pour lui signifier à mon tour cet interdit, mais au fond de moi, je n’étais pas très convaincu de mes chances de réussite, car ce n’était pas la 1ère fois que cela lui était dit.
Sa propre mère, la grand-mère maternelle donc, me dira avoir également essayé de dire à sa fille que « ce n’était pas bon pour son fils qu’elle dorme avec lui, d’autant plus qu’il grandissait… »
Quelle solution pouvait-on trouver pour que Robinson puisse dormir tranquille ?
C’est en ces termes que je posais le problème.
C’est alors qu’il eut l’idée de demander à son père d’installer un verrou dans sa chambre afin de prévenir et d’empêcher les intrusions maternelles.
J’ai trouvé l’idée un peu radicale au début, et après tout, pourquoi pas … ?
Son père répondra présent à l’interpellation de son fils, confirmant en cela la proposition de Lacan:
« Le père, on peut s’en passer à condition de pouvoir s’en servir. »
Robinson renoncera à entrer dans les limbes et prendra possession de son corps d’adolescent au fur et à mesure de ses métamorphoses.
Qu’est-cequi s’est joué alors pour Robinson dans ce dénouement ?
Pour qui le verrou a t-il été efficace ?
Pour sa mère tout d’abord qui verra sa jouissance du corps de Robinson verrouillée par l’intervention de son mari.
Pour Robinson ensuite, car en verrouillant sa porte de chambre, son père verrouillait sans le savoir la porte d’accès aux limbes, signifiant ainsi à son fils de quel côté de la porte il était attendu par son père.
C’est d’ailleurs à partir de ce moment que Robinson pourra quitter sa mère et faire avec son père des sorties dominicales, notamment dans les fêtes foraines.
Étonnante destination, vers un lieu où ils pourront faire leurs manèges, c’est-à-dire pour Robinson expérimenter avec son père une forme de rivalité complice, entre hommes.
Il pourra ainsi prendre appui sur les insignes du père pour se libérer de l’entrave du désir maternel.
Dans ce cas, le père de Robinson aura pleinement joué la fonction d’autrui pour son fils.
Dans sa postface au livre de Michel Tournier, Gilles Deleuze donne des pistes de réflexion intéressantes pour réfléchir à la place et au rôle d’autrui dans notre perception du monde.
Il considère notamment ( p 278) : « Autrui est un étrange détour, il rabat mes désirs sur les objets, mes amours sur les mondes.
La sexualité n’est liée à la génération que dans un tel détour qui fait passer par autrui d’abord la différence des sexes.
C’est d’abord en autrui, par autrui, que la différence des sexes est fondée, établie. »
Instaurer un monde sans Autrui, frapper à la porte des limbes, c’est tenter de vivre en évitant la question de la sexualité ordonnée par la différence des sexes.
Est-ce un hasard si la phobie dite « scolaire » apparait au moment de la puberté, au moment où la sexualité se manifeste dans le corps ?
Ne devrait-on pas plutôt parler de phobie de la sexualité ou de la différence des sexes, pour désigner ces pré- ados qui ne peuvent plus se rendre au collège ?
Pourraient-ils rejoindre plus tard la communauté des a-sexuels dont le fondateur, l’américain David Jay dira avoir découvert son a-sexualité vers 13,14 ans, « quand d’autres lui ont fait comprendre qu’ils désiraient quelque chose de lui… » ?