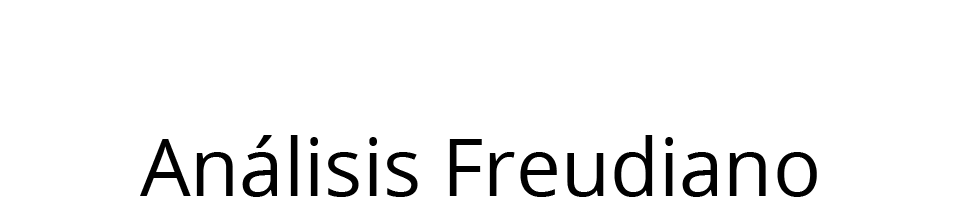Psychose de transfert et guérison. Chantal Cazzadori
Psychose de transfert et guérison.
Chantal Cazzadori
Amiens, Avril 2018
Rencontrer un analyste, c’est attendre un soulagement de sa souffrance quelque soit sa structure psychique :
C’est avec une certaine qualité d’Ecoute et de Silence que le sujet qui rencontre un analyste est accueilli. Un silence qui devient support de l’écoute du patient autrement dit qui laisse la parole à l’Autre, encore faut-il que l’Autre parle. On entend par l’AUTRE, le trésor des signifiants, soit, ce qui a été réceptionné par la lalangue. Au début de la vie, l’enfant entre dans les signifiants de l’Autre, la mère, pour acquérir le langage. Il se constituera avec beaucoup d’Autres de son entourage familier pour peu à peu s’en départir, acquérir ses propres raisons de vivre et faire ses choix après maintes séparations promotionnantes dans le meilleur des cas. Il sera responsable alors de ses mots, pour le dire autrement de son inconscient constitué de ses propres signifiants en qualité de sujet, de parlêtre. L’inconscient est structuré comme un langage nous dira Lacan.
La neutralité de l’analyste se manifeste donc jusqu’à un certain point, sachant qu’il ne prendra pas parti car son écoute bienveillante permettra progressivement au patient de départager les tords et de reconnaître enfin, en quoi il a pu être le partisan de son propre malheur.
On n’indique pas une analyse à quelqu’un comme on recommanderait une intervention chirurgicale par exemple. Lorsque que l’on va voir un analyste, c’est avec une certaine dose de souffrances que l’on ne peut plus gérer. Il n’y a plus d’arrangement possible. La vérité refoulée apparaît non plus dans les rêves ou dans un symptôme transitoire, mais elle se dit à moitié, à travers des limitations ou inhibitions, une explosion d’angoisse ou un délire. L’analyse est le moyen que l’on se donne pour accueillir autrement cette vérité, c’est-à-dire avec des mots.
L’analyste aura à accueillir toute demande d’analyse quel quelle soit, car ce n’est pas au patient de s’adapter à la cure, mais à l’analyste et au cadre de s’adapter au patient.
La psychose, une réponse à l’ événement via Philippe Julien, Freud et Lacan (1)
Il n’est pas du tout aisé de repérer si le patient que nous avons devant nous pour la première fois (hors la phase de délire déclarée) appartient à une structure psychique plutôt qu’à une autre. Lorsque l’éclosion psychotique n’est pas survenue, lorsqu’elle est seulement latente, un psychotique ressemble comme deux gouttes d’eau à un névrosé.
« Le dit prépsychotique n’est pas reconnaissable comme tel. Il se conduit, semble-t-il, comme tout le monde ; socialement parlant, il réussit assez bien à faire son petit bonhomme de chemin. De quelle manière ? « Par une série d’identifications purement conformistes à des personnages qui lui donneront le sentiment de ce qu’il faut faire pour être un homme », (Lacan, p. 231 Le Séminaire, livre III), ou ce qu’il faut faire pour être une femme.
Ainsi « par l’intermédiaire d’une imitation, d’un accrochage » (Ibidem, p. 217) à l’image du semblable, du pair, qui lui sert de béquille, le prépsychotique peut vivre sans qu’une psychose se déclare. Il vit « dans son cocon, comme une mite ». (Ibidem p. 285).
Jusqu’à sa mort ? Pourquoi pas en effet ? N’est-ce-pas la situation de tout le monde, tout au moins celle de l’homme moderne réduit « à rester très peureusement dans le conformisme »(Ibidem, p.226), selon des moules extérieurs et des stéréotypes de comportement ?
C’est justement ce que la théorie comportementalisme utilise comme mode de guérison ; ça se répète dans le pair jusqu’au jour où surgit l’im-pair : il arrive que l’ événement comme rencontre du Réel vienne bousculer cet équilibre. Contingence de l’événement ! Il n’est pas prévisible en vertu d’un mouvement purement immanent et d’une préhistoire déterminante. Mais cela peut arriver… à certains !
Il n’y a pas de psychogenèse de la psychose. Si l’on entend par genèse un mouvement imminent conduisant nécessairement à tel terme. Ce serait tout attribuer au psychisme.
Ainsi Lacan interrogeait : « Une psychose a-t-elle, comme une névrose, une préhistoire ? » Et il répondait : « Tout laisse à penser que la psychose n’a pas de préhistoire. » Apparemment, « rien ne ressemble autant à une symptomatologie névrotique qu’une symptomatologie prépsychotique ».(Ibidem, p.216).
Quand une nouvelle donne dans la vie du sujet l’interpelle que peut-il se passer ?
Il arrive fortuitement qu’un événement comme rencontre du réel fasse rupture avec des significations acquises ; un événement qui fait supplément, suivant le mot d’ Alain Badiou.
En effet, il est ce supplément, transgression des règles admises et des garanties reconnues selon ce qu’ordonne la loi des échanges. Bonheur ou malheur, l’événement est un en-plus, qui fait impair :
- d’un côté, une rencontre amoureuse, une prochaine paternité, une découverte scientifique ou artistique, une cause politique ou militaire, une révélation religieuse ;
- de l’autre, une trahison conjugale, un décès inattendu, une faillite professionnelle, une défaite politique ou militaire, une désolante nuit mystique.
Chaque fois, à une vérité nouvelle, le savoir manque, et l’interrogation demeure suspendue.
La vérité singulière outrepasse le savoir qui répondait jusqu’alors. Il y avait coïncidence entre savoir et vérité, mais voici que tout à coup l’événement fait supplément.
Quant à une vérité nouvelle, le savoir manque, et l’interrogation demeure suspendue, quelle va -être la réponse psychotique à cette interrogation ?
Nous reviendrons sur ce sujet après avoir fait un tour vers le cadre oedipien, la projection et le narcissisme puis la question du père. Mais avant le rappel de ces théories freudiennes et lacaniennes, suivons les interrogations premières de Freud.
Quelques considérations historiques sur la psychose paranoïaque selon Pierre Kaufmann via Freud (2)
C’est à partir de l’étude de l’hystérie et de la névrose obsessionnelle, que se développera l’interprétation psychanalytique de la paranoïa.
« En psychiatrie, écrit Freud le 24 janvier 1894, les idées délirantes doivent être rangées à côté des idées obsessionnelles, toutes deux étant des perturbations purement intellectuelles ; la paranoïa se place à côté du trouble obsessionnel en tant que psychose intellectuelle. Si des obsessions sont imputables à quelque trouble affectif et si nous démontrons qu’elles doivent leur puissance à quelque conflit, la même explication doit être valable pour les idées délirantes. Ces idées découlent d’une perturbation affective et leur force est due à un processus psychologique. Les psychiatres sont d’un avis contraire, tandis que les profanes ont l’habitude d’attribuer la folie à des chocs psychiques… Le fait est là : la paranoïa chronique sous sa forme classique est un mode pathologique de défense comme l’hystérie, la névrose obsessionnelle et les états de confusion mentale. »
Plus précisément donc, selon le principe d’explication admis par Freud dans sa généralité, « ces gens deviennent paranoïaques parce qu’ils ne peuvent tolérer certaines choses ». Encore faut-il, ajoute-t-il, que leur psychisme y soit particulièrement disposé.
Quelle est donc la spécificité de la défense paranoïaque ? Projection et retrait de croyance ?(2)
C’est alors qu’est introduit le mécanisme de projection. Schopenhauer en avait marqué l’importance, mais Freud en a renouvelé la notion – l’interprétant comme équivalente à un refoulement – à la différence du refoulement hystérique, qui porte en premier ressort sur le contenu qui le motive. En 1896, Freud envisage le souvenir de cet incident primaire, sans doute analogue à celui qui engendre la névrose obsessionnelle ; le souvenir de cet incident, le déplaisir qu’il provoque ; le refoulement consécutif ; la projection. Mais à ce processus tout à fait caractéristique est associé le retrait de croyance. Entendons par là, la déconnexion vis-à-vis du Moi, ou désappropriation, d’un contenu incompatible avec l’identité que se reconnaît le sujet. Plus précisément la conscience refuse de donner créance à l’auto-reproche, et à cette fin emploie la procédure de la projection. C’est le prochain qui est rendu responsable du déplaisir. Le premier symptôme ainsi formé est celui de la méfiance, susceptibilité exagérée à l’endroit d’autrui.
Les voix représentent les auto-reproches à la façon d’un symptôme de compromis ;
« l’importance attribuée aux voix en tant qu’image de relations avec autrui et aux gestes qui nous révèlent la mentalité des gens, l’importance aussi du ton de leur observations et de leurs allusions, tout cela émane du fait que le conscient ne saurait admettre aucun rapport direct entre contenu des observations, et le souvenir refoulé ». Ecrira Freud le 1er janvier 1896.
Le reproche intérieur est repoussé au-dehors, autrement dit le refoulement s’effectue par retrait de croyance poursuit Freud, le contenu et les affects de l’idée intolérable sont maintenus mais se trouvent projetés au-dehors.
« … La psychose est, pour Freud, absolument fondamentale. L’invitation de Lacan selon laquelle la psychose est ce devant quoi un analyste ne doit reculer en aucun cas », est a priori admise par tous ceux qui s’orientent de son enseignement. »
Freud avait déjà une conception relativement complète de ce qui structure les névroses lorsqu’il a rencontré Jung, directeur d’un célèbre hôpital psychiatrique à Zurich.
Étendre ainsi la conception psychanalytique du champ des névroses à celui des psychoses, telle était la demande réelle du découvreur de l’inconscient à celui qui deviendra pour un temps son ami et disciple, le jeune psychiatre médecin Suisse Carl Gustav Jung.
C’est donc Jung qui mit Freud sur la piste des Mémoires d’un névropathe, livre écrit par D. P. Schreber, président de Chambre à la cour d’Appel de Dresde, et qui retrace l’histoire de son délire et de son hospitalisation entre 1893 et 1900.
Que ce soit dans la paranoïa, avec ses divers aspects de délires comme : l’érotomanie, le délire de jalousie ou la mégalomanie, l’insistance de Freud sur l’aspect homosexuel rejeté et dénié qui provoquerait le délire du paranoïaque le pousse à trop accentuer le rôle de l’homosexualité dans ses analyses. De ce fait, il va ignorer ce qui persécute un fils en attribuant à Fliess, Jung et Ferenczi son interprétation justement trop convaincante du rôle de l’homosexualité dans ces persécutions. Ainsi, en méconnaissant ce qui persécute un fils, Freud passera à côté de la découverte majeure la laissant en suspend.
Or, c’est lorsque lui-même ne se reconnait pas comme fils de son propre père, qu’une perturbation dans l’ordre des générations va se manifester de cette manière, ce sera l’apport de Lacan qui ouvrira ainsi une nouvelle perspective de recherche.
Le point de vue de Lacan concernant la paranoïa. (3)
On pourrait dire que Lacan a repris l’interprétation du cas Schreber où Freud l’a laissé en suspens, à savoir la question de la procréation et de la paternité.
C’est dans le Séminaire sur les psychoses, 1955-1956 que cette question a été reprise de la manière la plus propre à l’éclairer.
« L’hypothèse de départ de Freud était qu’il pouvait aborder ces manifestations psychiques à la lumière des connaissances que la psychanalyse avait acquise des psycho-névroses, parce qu’elle découlait des mêmes processus généraux de la vie psychique. Ainsi, dans les rapports que, dans son délire, Schreber entretient avec Dieu, il retrouve, transposé, le terrain familier du « complexe paternel ». Il reconnaît en effet dans ce personnage divin le « symbole sublimé » du père de Schreber. Rapport fait à la fois de vénération et d’insubordination. De même, dans la subdivision entre un Dieu supérieur et un Dieu inférieur, il retrouve les personnages du père et du frère aîné. »
Revenant à la lecture freudienne du texte de Schreber, Lacan introduit une donnée essentielle pour comprendre ce que Freud appelle le « complexe paternel », chez le névrosé et ce qui le distingue de ce que l’on rencontre chez le psychotique, éclairant du coup considérablement ce que signifie la prétendue « homosexualité » du paranoïaque. Cette donnée est celle de la fonction paternelle symbolique, ou métaphore paternelle, désignée encore sous le terme de Nom-du-Père, qu’il convient de distinguer du père, c’est-à-dire de la place qu’elle réserve à la fonction symbolique dans la promotion de la loi. Chez le paranoïaque, cette métaphore n’est pas opérante.
« En axant son interprétation sur le délire de persécution, Lacan en arrive à l’hypothèse que, parce qu’il n’a pu être père, (Schreber n’avait pas d’enfant), Schreber se prend pour cette femme afin de résoudre l’énigme de la procréation. L’étude du cas permettra à Lacan de dégager le concept de forclusion. Le signifiant être père, le signifiant du Nom-du-Père est forclos chez Schreber. A sa place, apparaît dans le délire, la production du délire du thème de la procréation.
En s’intéressant aux écrits du père de Schreber, qui était un grand médecin connu surtout pour son zèle réformateur et éducationnaliste, Lacan formule l’hypothèse que dans ce cas, c’est le rapport du père à la loi qui génère la psychose du fils. Là où Freud considérait le père comme un « père excellent… ».
La forclusion du Nom-du-Père chez Schreber comme structure psychotique (4)
Précisons en quoi cette métaphore Nom-du-Père est inopérante chez le paranoïaque. Nous dirons que la fonction paternelle symbolique, il convient de la distinguer du père réel en ce qu’elle résulte de la reconnaissance par une mère non seulement de la personne du père, mais surtout de sa parole, de son autorité, c’est-à-dire de la place qu’elle réserve à la fonction paternelle dans la promotion de la loi, comme nous l’avons dit précédemment.
C’est à partir de la reprise de l’étude du cas Schreber que Lacan fait la démonstration que la question de la paranoïa devient celle, tout à fait générale, de la structure de la psychose.
Cette forclusion signifie qu’au lieu du Nom-du-Père, il y a un trou, qui produit chez le sujet un trou correspondant à la place de la signification phallique, ce qui provoque chez lui, lorsqu’il se trouve confronté à cette signification phallique, le désarroi le plus complet. C’est ainsi que se déclenche la psychose chez Schreber, au moment où il est appelé à occuper lui-même une fonction symbolique d’autorité, situation à laquelle il ne peut que réagir par des manifestations hallucinatoires aiguës, auxquelles peu à peu la construction de son délire viendra apporter une solution, constituant, à la place de la métaphore paternelle défaillant, une « métaphore délirante », destinée à donner un sens à ce qui, pour lui, en est totalement dépourvu.
Du complexe d’Oedipe à la métaphore paternelle. (5)
Pour être plus explicite, revenons sur le complexe d’Oedipe ou comment le père devient porteur de la loi : nul père, qu’il soit réel ou imaginaire, ne suffit à la fonction, ne peut la remplir pleinement, puisqu’il s’agit de la loi symbolique c’est-à-dire de la loi même du signifiant, et du père symbolique, il n’y a que traces dans le texte même du discours.
La question n’est nullement réglée par le meurtre du père de la horde primitive perpétrée par ses fils : ce mythe freudien, exposé dans Totem et tabou. Lacan nous le fera remarquer dès 1938, dans les Complexes familiaux dans la formation de l’individu. Il propose de rendre compte de la fonction paternelle, en tant qu’instauratrice de la loi symbolique, par une écriture (ses petites lettres) de la métaphore. Cette métaphore paternelle est liée à la mise en place du signifiant phallique comme signifiant central de toute économie subjective.
En 1956-57, dans le séminaire IV, il dénonce vigoureusement la conception alors en cours de la relation d’objet, visant à faire découler tout le développement du sujet de sa relation à la mère décrite en termes duels et aussi dans les termes de la relation réelle. Ce n’est pas freudien de penser ainsi. Ce que Freud reconnaît comme central dans l’économie libidinale, c’est la notion de tiers imaginaire qui est le phallus, soit l’image de l’organe érigé. Si l’enfant est réel et la mère symbolique, il faut adjoindre à cette dyade le phallus en tant que l’enfant ne vaut pour la mère que comme répondant plus ou moins pour elle au Penisneid, l’envie du pénis.
Inversement, pour l’enfant, la mère ne vaut qu’en tant qu’elle satisfait à point nommé ses besoins ; mais justement elle ne les satisfait pas toujours. Présente, absente, au bon moment ou pas, la mère sera celle qui donne comme « pure puissance de don », capable de donner selon son bon vouloir auquel l’enfant est assujetti par conséquent.
C’est là que l’enfant va symboliser la mère comme puissance, en faire une mère symbolique. Dans le jeu du fort-da, Freud a montré que seul un symbole peut rendre compte de la présence sur fond d’absence et réciproquement.
« Lorsque la mère ne donne pas, elle frustre l’enfant de l’objet imaginaire. Lacan reprend la théorisation de la frustration en la comparant à la privation (manque d’un objet réel) et à la castration (dette symbolique). Il montre les limites de la fonction de la frustration dans la théorie du complexe d’Oedipe, en observant que chez Freud (dès l’Esquisse d’une psychologie scientifique »), l’objet de la tendance a été originellement perdu et ne saurait être retrouvé le même : des les premières vocalisations, la demande s’exprime par la parole, et à passer par le défilé du signifiant, l’objet originel du besoin « perd sa particularité d’être l’objet de cette fois-là » : il est à ce titre « un rien d’objet » et s’il est procuré l’enfant ne peut qu’y « écraser son insatisfaction fondamentale ». Du fait de la dialectique de la demande et du désir, l’objet ne saurait combler le désir qui est en deçà ou au-delà de la demande et on est amené à constater que « ce qui est désiré c’est très précisément l’impossible ».
Passer de l’imaginaire au symbolique en accédant au trou dans le réel. (5)
Au delà de la frustration, l’enfant va se sentir privé de quelque chose, de même que la mère est privée du phallus. A la dialectique de la frustration, il faut donc adjoindre celle de la privation, ce sera l’apport propre de Lacan, fondé sur le constat d’un trou dans le réel.
Comment accéder à ce manque d’objet, ce trou dans le réel ? L’enfant naît dans un monde de langage, c’est un monde symbolique qui l’entoure dès avant sa naissance. Un réel déjà symbolisé l’attend, l’accueille, mais comment cet enfant va-t-il accéder à la structure du réel, du symbolique et de l’imaginaire de la mère ?
« C’est là que la phallus prend tout son rôle pour autant que l’enfant peut être amené à saisir que la mère désire quelque chose au-delà de lui et qu’elle n’a accès au terme phallique qu’au travers du père : la structure RSI de départ constitue une « amorce de symbolicité » et prépare la fonction du père en tant que c’est lui qui a la puissance et l’usage légitime du phallus, qui est en mesure d’interdire la mère à l’enfant comme objet de ses premières aspirations sexuelles, mais aussi de donner à l’enfant, au terme du complexe d’Oedipe, un futur usage légitime de son propre phallus : à travers le complexe de castration, l’enfant a en effet à « renoncer à son phallus pour le tenir d’un autre qui le lui donne » en même temps qu’il lui donne accès au monde symbolique : ce tiers terme qu’est au départ le phallus imaginaire entre la mère et l’enfant est donc l’amorce de l’accès à toute la dialectique symbolique sur le fond d’une expérience de perte.
Si le transfert guérit… mais qu’est-ce qui guérit du transfert ? (6)
« La psychanalyse a été inventée par Freud comme procédé thérapeutique, en effet quoiqu’on en ait dit, quoi qu’on en dise, un procédé destiné à soulager les « maladies nerveuses » (soulager les névroses, tel est son destin) et c’est le terme de guérison qui revient en maintes occurrences sous sa plume tout au long de son oeuvre jusque et y compris dans ses travaux testamentaires », Analyse finie, analyse infinie, l’Abrégé, Clivage du moi.
Sa vocation était selon ses dires et ses actes la recherche plutôt que soigner. Freud était un chercheur, neurologue d’abord, pas psychiatre, pas clinicien, pas soignant et dont le terme de guérison, insiste tout au long de son oeuvre. La guérison ne pourrait-elle pas, alors, se rencontrer comme séparée, indépendante, parfois de la médecine ?
En instaurant la cure de la parole, ce signifiant guérison va changer de nature. L’association libre comme mise en acte de l‘inconscient fait surgir à travers les mailles de la parole, échappées au refoulement, séance après séance, un savoir insu. Ces traces d’expériences refusées feront symptômes pour se faire reconnaître ce qui fait de l’inconscient un lieu de la vérité du sujet. C’est l’analyste qui va nasser, prendre dans son filet ces étincelles de jouissance, ces éclats de savoir que le sujet va découvrir sur lui-même avec effroi ou émerveillement. Ce n’est pas le symptôme en soi, isolé de tout contexte qui est l’objet du travail analytique, mais la fonction que ce symptôme occupe dans l’économie psychique de l’analysant, sa raison d’être et de se répéter, et dont ces signifiants sont le vecteur.
C’est par l’opération transférentielle, au coeur du dispositif, ce transfert par ce qui s’y véhicule du passé au présent qui va permettre par-delà le symptôme et les résistances, de dénouer les « fausses connexions » et les leurres, et de remettre le Sujet en souffrance et en panne, en mouvement. Comment alors saisir les signifiants de son histoire ? Signifiants noués au corps et ainsi d’opérer les remaniements pulsionnels qui lui permettront de lâcher son symptôme et ses jouissances morbides devenues obsolètes. Il pourra dès lors investir de nouveaux objets et s’ouvrir aux autres et au monde. Si d’aventure le symptôme, dans des moments de vulnérabilité, réapparaissait, il n’y serait plus aliéné et « saurait faire avec » sans l’occulter et resterait ainsi acteur de sa vie.
Processus de symbolisation, de transformation « là où le ça était, le Je doit advenir ».
Ce qui s’accomplit dans une cure est précisément ce que Freud désigne comme un travail de civilisation et d’un travail d’humanisation, au coeur duquel la guérison vient de surcroît.
En 17 points Jean-Michel Louka va explorer un peu ce qui s’opère, ce qui est à l’oeuvre dans le travail de la cure suivie par des névrosés pour construire sa réponse :
- 1. « Le transfert, c’est l’amour » ( Jacques Lacan) !
- 2 . « L’ amour de transfert est un amour véritable » ( Sigmund Freud).
- 3 . L’amour est-il médecin, thème classique, question? Réponse, oui … mais pas assez ! Il ne suffit pas. Il peut soigner, un temps, mais il ne guérit pas. Plus, il ne peut guérir ce dont il s’agit en l’occasion.
- 4 . Freud nous a enseigné comment guérir – à tout le moins, prendre le chemin de la guérison – une névrose (hystérie, névrose de contrainte, phobie) : il faut la transformer en névrose de transfert. Alors, là, elle devient accessible à l’analyste et à son analysant. Elle peut être analysée.
- 5. Dire que le transfert guérit… ne dit pas de quoi ? De quoi le sujet serait-il « malade »? De son Moi ? De la vie ? Du fait que nous sommes mortels ? Du désir ? De la jouissance ? De ses pulsions indociles ? De la bêtise, de la sottise universelle ? De l’amour lui-même ? De la haine ? De l’indifférence ? De la vérité ?
- 6 . En tout cas, si la psychanalyse via le transfert, – l’amour de transfert -, guérit, elle ne correspond en rien à la guérison définie en médecine depuis toujours, comme le rappelle le serment d’Hippocrate : « restaurer l’état d’avant la maladie ou l’accident ». Ce serait même tout le contraire, puisque l’état d’avant, c’était justement celui, insupportable pour le sujet, qui l’a rendu « malade », souffrant, en souffrance. Le sujet en souffrance… comme la lettre du même nom, à la poste… Une lettre qui n’a pas été distribuée, qui n’est pas parvenue à destination, pas parvenue au sujet qui doit aller la chercher… Et cela s’appelle une analyse, son analyse !
- 7. Peut-on guérir, un peu, beaucoup, passionnément… Pas du tout ? Oui, mais toujours la psychanalyse transforme.
- 8 . Le mieux, c’est de guérir un peu, voire beaucoup … mais pas tout à fait ! Qu’il reste un reste de symptôme, et que le sujet l’aime, son reste de symptôme, comme lui-même (Lacan, là aussi). Qu’il en reste un bout afin de faire avec lui (« savoir y faire avec son symptôme » toujours Lacan) plutôt qu’être refait par lui !
- 9 . Alors, guérir de quoi ? En fait, on pourrait dire guérir de l’Autre (grand A) en cessant d’attendre qu’il se barre… mais le barrer soi-même. Tout cela repose, bien sûr, sur le transfert et, plus précisément, sur l’amour de transfert qui vous fait prendre, paradoxalement, le chemin de la guérison. Le chemin seulement. C’est cette opération de barrer l’Autre qui seule, parce que faite, effectuée par l’analysant lui-même, guérira au sens psychanalytique, non-médical donc, le sujet de son amour névrotique, son amour ordinaire, c’est-à-dire de sa demande d’amour à l’Autre qui n’existe pas. Le transfert, à la guérison, il s’y colle. Le plus étonnant, c’est que ça marche.
- 10 . Le psychanalyste, un temps, doit, sinon être, tout du moins représenter l’Autre pour le sujet en analyse. Qu’il soit positif ou négatif ce transfert importe peu, l’important c’est qu’il forme et vectorialise le cadre transférentiel, sans lequel il ne peut y avoir d’analyse.
- 11 . Que ce soit l’amour que se portent les amants ou celui qui éclot et se révèle, via l’amour de transfert dans l’analyse, il s’agirait dans les deux cas d’un amour véritable. Alors où se placerait la différence ? Eh bien pour les amants, dit Patrick Avrane dans son livre Les chagrins d’amour (2012 au seuil), l’un des amants ne représente jamais complètement l’Autre pour son amant et son amante. Alors que dans l’analyse, pour entreprendre son analyse, le futur analysant doit s’adresser à quelqu’un, « élire » ce quelqu’un en quelque sorte, qu’il ne peut alors éviter d’investir à cette place manquante d’Autre pour lui.
- 12. La situation amoureuse est imaginaire, l’autre de l’amour est mis en place du Moi idéal de l’amant. La situation dans le cadre analytique est différente, c’est la demande de l’analysant dont le psychanalyste accepte d’être investi mais au service d’un but inatteignable sans cela. L’analysant investit l’analyste à cette place Autre, en lui demandant de le guérir de ses symptômes, il s’en remet à lui et, chose toujours curieuse, l’analyste accepte. Le dispositif est fondamentalement leurrant, parce que l’analyste, lui, est averti de ce leurre. L’analysant le découvrira plus tard au fil de sa cure par un travail de perlaboration. Pour les amants, le leurre de l’amour en tant qu’imaginaire est, à leur insu, partagé. Quand on s’aime, c’est toujours réciproque, nous disait Lacan. La passion, elle, ne l’est pas nécessairement des deux côtés. La demande et le dispositif analytique sont leurrants, l’amour reste, lui, véritable, dans les deux cas.
- 13. Le cas d’Anaïs Nin est à ce titre très éclairant. Elle couche successivement avec ses deux analystes, René Allendy, puis Otto Rank. Et, entre ces deux épisodes, elle réalise l’inceste avec son père durant plusieurs semaines. Elle ne tombe pas amoureuse, mais eux si ! Catastrophe, le différentiel les fait verser dans « le chagrin d’amour » au sens de l’étude d’Avrane. Elle non. C’est eux qui demandent, la demande s’est ici inversée. Anaïs profite d’eux. Anaïs ne vit pas sa vie, elle l’écrit comprend Otto Rank. Pas de guérison possible ici du transfert et de son amour. Car pas d’amour véritable et pas de demande sincère, pas d’autre en place d’Autre possible. Il y a leurre du leurre. A ce jeu, Anaïs est beaucoup plus forte, mieux aimée que ses psychanalystes.
- 14. A Quel moment, quand, dans quelles conditions est-ce que le sujet arrive à barrer l’Autre, chemin pour lui avancé vers sa guérison ? Quand il a suffisamment tourné sur un divan, mis à l’épreuve son analyste dans l’amour de transfert, cherchant à le faire chuter dans la haine ou dans l’amour ou, troisième passion repérée et ajoutée par Lacan, dans l’ignorance. Quand il a bien tiré sur la corde du transfert, que celle-ci n’a pas lâchée, mais que celle-ci ne l’a pas plus ficelé pour qu’il ne bouge plus et reste là éternellement aliéné au divan, alors… quelque chose peut devenir qui s’appelle la « destitution subjective ». Ainsi peut naître le sujet, au moment même et consécutivement, son analyste va se retrouver dé-posé de cette place d’Autre pour lui. Son psychanalyste n’a alors plus d’être à ses yeux, à ses oreilles, c’est son « désêtre » qui vient à se réaliser. Et l’analyste est toujours frappé de le ressentir parfaitement comme tel.
- 15. Fin d’analyse ! Ce moment ne doit pas survenir trop tôt, empêchant l’analyse de se boucler comme il se doit. Ni trop tard, empêchant ainsi toute sortie par le haut du processus, éternisant l’analyse dans une sans-fin épuisante. Nous ne serions plus dans la « guérison » au sens freudien de l’ouverture sur le monde et la culture en s’humanisant. Il s’agirait non plus là, d’une guérison, mais d’un « coma dépassé ».
- 16. Si la guérison a été dite « de surcroît » par Lacan, ce n’est sans doute pas pour rien. En effet, si on la vise directement, en analyse, on la rate. On fait le médecin, pas l’analyste. En ne la visant pas, on introduit une chance de l’obtenir… de surcroît. Ce n’est pas qu’on la refuse, c’est que l’on ne peut pas l’aborder de front, comme le symptôme, car elle lui est liée. L’analyste ne va pas aborder frontalement le symptôme, tout au moins, en faire quelque chose d’autre qu’une source de souffrance pour le sujet que seule une analyse bien conduite permettra.
- 17. Alors la psychanalyste reste bien ce qu’elle était pour Freud, entre autres, un procédé thérapeutique, mais un procédé thérapeutique qui doit rester non médical, qui se sert et s’appuie sur le transfert, sur l’amour de transfert pour ne pas viser la guérison, bien qu’ainsi se donner une chance de l’atteindre de surcroît. Car, pour la psychanalyse freudienne, lacanienne ou depuis Lacan, il n’y a de vérité que du sujet. Entre savoir et vérité, telle reste notre assiette.
PSYCHOSE DE TRANSFERT qu’en est-il ? (7)
Dans la revue d’Analyse Freudienne Presse « Au commencement est le transfert », plusieurs auteurs exposent sur cette question dont Françoise Fabre ici présente.
Son article intitulé :
« l’interprétation est-elle possible dans le cadre des Psychoses » elle nous dira :
Après avoir raconté une anecdote concernant une pièce de Dubillard « Olga, ma vache », qui nous renvoie un grand malaise et nous dérange, puisque ce texte non moral est construit, non pas comme un texte métaphorique et poétique qui donnerait plus de relief à son aspect fantastique, mais comme un délire, précisera-t-elle.
« Cet homme est dans la certitude avec tous les éléments du délire, dans l’absence de toute métaphore et c’est probablement ce qui trouble les personnes peu habitués à ce genre de discours ». F. Fabre qui travaille beaucoup avec des délirants, en les entendant autrement peut se dire, en un certain sens charmée par l’histoire.
A la question « peut-on interpréter ou non les psychoses ? » :
Elle poursuit : « Au sens habituel du terme, il faut du refoulement, du déplacement, ce qui est le cas dans le champ de la névrose, mais là, dans les psychoses, on admet qu’il n’y a pas de refoulement, donc pas d’équivocité signifiante. Ce que l’on nomme interprétation ne semble pas pertinent dans le champ de la psychose. Par contre, ce qui apparaît pertinent, c’est le maniement transférentiel avec les possibilités d’effets d’acte qui ne sont pas liés à l’interprétation. Le maniement du transfert ne relève pas toujours de l’interprétation. Il y a aussi des interventions qui vont avoir des effets d’acte. Un effet d’acte est-il de l’ordre d’une interprétation ? La question est ouverte. Pour ma part, quand je parle d’effet d’acte, je ne le relie pas obligatoirement à une interprétation au sens strict du terme ».
« Chez le psychotique, c’est une vraie création car les signifiants, il n’y en a pas en tant que tels. Il y a quelque chose qui va se constituer, un peu comme le lieu de l’inconscient, création totale liée au transfert qui ne peut pas s’appuyer sur les signifiants du patient. On pourra dire que se met en place un certain nombre de noms qui vont tenir lieu de signifiants. Dans ma pratique libérale avec les psychotiques que je reçois, je peux dire que la séance, le cadre et le bureau deviennent un lieu qui dépasse le lieu psychique. L’espace géographique compte et se trouve souvent repéré comme un lieu spécial. Cela fonctionne comme l’inconscient. Ces éléments que le patient va retrouver et que l’analyste pourra redonner, permettront que la jouissance du patient soit apaisée.
Après avoir parlé d’un exemple clinique, elle conclue ainsi :
« C’est la seule fois, dans ma pratique, où j’estime avoir fait une interprétation à un psychotique. Mais si cela a eu lieu une fois, cela veut dire que cela peut se faire. Il y a sans doute des conditions, cela ne peut avoir lieu avec tout le monde. Mais je dirais que si, dans l’ensemble, il n’y a pas d’interprétations à faire dans le champ de la psychose, on peut introduire un écart dans ce que les patients disent de leur monde en faisant jouer un peu d’altérité. Au départ, mon idée était celle-là : ne pas complètement adhérer et marquer un écart, c’est ce que je pratique avec les psychotiques. Dans cet exemple, l’effet n’était pas une équivocité signifiante mais c’était de passer de la position d’objet à la position de sujet. Cela a eu de l’effet comme une interprétation, et je laisse ouvert la question de la définition. C’est la seule fois où j’ai pu repérer quelque chose de l’interprétation dans les psychoses ».
Carol waters conclura son article sur le transfert dans la psychose :
« Pris dans le transfert, le sujet psychotique propose à l’analyste la place de celui qui sait et qui jouit, écueil à éviter sous peine d’installer une érotomanie mortifère.
Contrairement à la direction de la cure chez le névrosé, toute équivoque est à proscrire, il s’agit pour l’analyste de quitter la place que Lacan nomme la place du mort, pour s’impliquer. Le traitement psychanalytique consiste à rechercher avec le patient un signifiant « idéal », faisant barrage à la jouissance. D. me demande constamment de vérifier, de confirmer ses « re-nominations ».
Amener le sujet, quelle que soit sa structure, à la dignité de sinthome est la tâche ardue de l’analyste postjoycien, il s’agit, au lieu d’un « ready-made », de faire du « sur-mesure » pour chaque sujet. Dans son transfert, ce que D. me demande de faire avec lui, c’est un minutieux travail d’artisan ».
Comme le préciseront Maria-Cruz Estada et Lola Monléon en introduisant ces texte de la revue :
« Ces « injonctions » supposent une implication de ces analystes qui ne se limitent pas à écouter leurs patients, mais qui font appel à la séparation du pulsionnel en jeu. En effet, que l’analyste accepte d’écouter et d’accueillir le réel ouvre un espace dans lequel peut se déployer le transfert qui, dans un travail de longue haleine fait surgir l’objet non noué et leur permet, ainsi, de tisser peu à peu la violence de l’Autre avec le fil de sa propre histoire ».
Chantal CAZZADORI
Psychanalyste AMIENS
dans le cadre de la conférence sur
« Peut-on guérir de la folie ? »
supplément de recherche sur ce sujet.
Amiens, le 9 avril 2018, salle Dewailly.
(1) Psychose, perversion, névrose, Philippe Julien, chapitre 5, p. 42,43
(2) L’apport freudien sous la direction de Pierre Kaufmann, article sur la paranoïa p. 292. Bordas.
(3) J. Lacan, séminaire sur les psychoses : 1955, 1956
(4) Dictionnaire de la psychanalyse sous la direction de R. Chemama et B. Vandermersch, p.298 le cas Schreber et 299 la forclusion du Nom-Du-Père.
(5) L’apport freudien sous la direction de Pierre Kaufmann, la métaphore paternelle p. 237, 238.
(6) Jean-Michel Louka, texte issu du livre : « Qu’est-ce que la guérison pour la psychanalyse ? » p.307 à 316 – article : le transfert guérit… Mais qu’est-ce-qui guérit du transfert ?
(7) Revue de 2012, Analyse Freudienne Presse chez ERES, n° 19 : « Au commencement est le transfert ».
article de Françoise FABRE : « l’interprétation est-elle possible dans le cadre des psychoses ? »
article de Carol Watters : « Voici un franc symbolique, docteur ». p.171 à 180
Introduction écrite par Maria-Cruz Estada et Lola Monléon dans cette revue 19, p.160